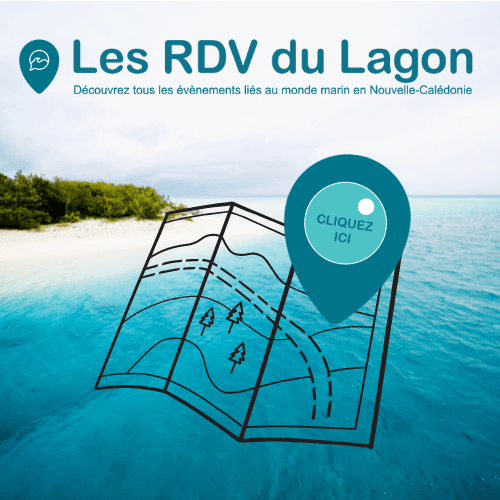Au départ, elle n’avait pas de nom. Pas d’étiquette, pas de label, juste une jolie carapace, un goût sucré et un mode d’élevage exigeant, à la calédonienne. Et pourtant, c’est bien cette crevette-là, la Litopenaeus Stylirostris, qui va peu à peu sortir de son bassin pour devenir une marque de fabrique du territoire.
Entre stratégie collective, montée en qualité et quête d’identité, la crevette bleue a fait plus qu’émoustiller les papilles nippones, elle a posé son ancre dans l’image de marque de la Nouvelle-Calédonie. Mais alors comment un crustacé est-il devenu l’un des porte-étendard du caillou ?
__
50 nuances de bleu
À la fin des années 80, la filière de la crevette calédonienne commence à prendre forme. Les fermes se développent, les premiers kilos sont expédiés vers le Japon, et la SOPAC est créée pour structurer l’ensemble. À ce moment-là, il s’agit surtout d’assurer un bon produit, une régularité, et de résoudre quelques équations techniques et biologiques. Mais très vite, une évidence s’impose. Dans un marché où les crevettes se comptent en millions de tonnes, la seule façon d’exister, c’est de se distinguer. Pas sur le volume (par manque de moyens et d’envie) mais sur la qualité, l’image, l’origine. Bref, sa signature.
C’est ainsi que naît la fameuse, l’unique, l‘irremplaçable Crevette Bleue de Nouvelle-Calédonie. Une marque collective, pensée par les producteurs, déposée en bonne et due forme, avec un objectif, celui de faire reconnaître cette crevette pour ce qu’elle est vraiment. Pas une simple Penaeus parmi d’autres, mais un pur produit du lagon, élevé sans antibios ni tricheries.
Et pourquoi bleue ? Parce que sa carapace tire vers cette teinte, mais aussi (et peut-être surtout) parce que c’est la couleur de notre beau lagon, celle de l’eau, du territoire, et de ce qu’il évoque. Bleu profond pour la mer, bleu clair pour la transparence, et bleu comme étendard d’un modèle made in calédonie.



__
La Beyoncé calédonienne
Définir une marque, c’est bien. Encore faut-il qu’elle tienne ses promesses. Dès les années 2000, les producteurs se mettent autour de la table, non pas pour manger des crevettes flambées, mais pour définir un cahier des charges commun. Densité limitée, alimentation maîtrisée, pas de traitement antibiotique, suivi sanitaire rigoureux, etc. En résumé, une aquaculture raisonnée, avant même que ce soit trendy sur Instagram. La fameuse a su se construire une belle image. Une qualité gustative reconnue, une traçabilité renforcée, un élevage en zone protégée, un modèle écologiquement responsable. C’est aussi à cette époque que la crevette bleue commence à faire parler d’elle dans les circuits professionnels. Elle est présente dans des salons spécialisés, mise en avant par certains chefs internationaux, et apparaît dans des campagnes de promotion d’institutions calédoniennes. C’est un peu la populaire du lycée.

Aujourd’hui, elle n’est plus simplement un produit d’export, elle est un emblème culinaire, un argument touristique, une carte de visite économique. Elle incarne un certain rapport au territoire ; fière mais modeste, exigeante sans arrogance, ancrée localement mais avec des ambitions internationales. On la retrouve dans les menus des chefs, dans les brochures touristiques, dans les discours politiques parfois aussi. Elle participe à raconter une autre Calédonie, tournée vers l’innovation douce, l’agriculture bleue, les savoir-faire discrets mais solides.
__
Quel avenir pour notre mascotte ?
Bien sûr, tout n’est pas rose (ni bleu). Le modèle calédonien reste fragile, avec des coûts de production élevés et une concurrence féroce des pays à bas coût. Mais notre crevette bleue aussi est féroce, et c’est justement parce qu’on mise sur ce qui la rend unique, plutôt que sur la rentabilité à tout prix, qu’elle continue d’exister, là où d’autres filières s’essoufflent.
Demain, elle peut encore grandir, en développant la transformation locale, en renforçant sa présence sur le marché calédonien et international, ou en obtenant de nouveaux labels, en plus du label ASC (Aquaculture Stewardship Council), que certaines fermes calédoniennes détiennent déjà. Une chose est sûre, elle n’est plus un simple produit. Elle porte une histoire, celle de la Calédonie.
Et pour comprendre comment cette signature est née, il faut revenir un peu en arrière, aux débuts de la filière, de l’écloserie à l’export. Mais ça, c’est pour le prochain épisode…


__