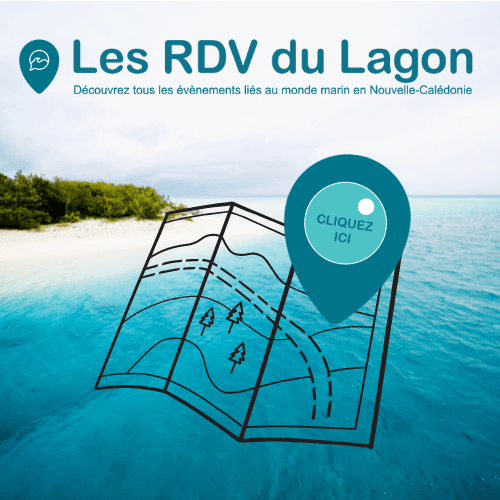Troquer son bureau contre un lagon turquoise, échanger son écran d’ordinateur contre une plage de ponte et avoir pour collègues des tortues marines ? C’est exactement ce qu’a fait Hugo Bourgogne, aujourd’hui coordinateur des programmes marins à l’antenne calédonienne WWF France. Pendant trois ans, il a écumé le Grand Lagon Sud, scruté les plages de ponte et passé des nuits blanches à attendre les fameuses tortues grosse tête.
Depuis qu’il a soutenu sa thèse en septembre 2024, il continue de se battre pour la conservation des tortues et des écosystèmes marins calédoniens. Entre anecdotes de terrain, défis de la recherche et conseils pour les jeunes chercheurs, Hugo a embarqué la rédac’ dans son univers pour cette interview passionnante !
__
Bonjour Hugo et bienvenue sur NeOcean ! Pour commencer en douceur, peux-tu décrire ton parcours à nos lecteurs en 3 mots et nous raconter pourquoi avoir choisi de plonger dans l’univers fascinant des tortues caouannes ?

Salut NeOcean ! Moi, c’est Hugo, je suis coordinateur des programmes marins à l’antenne calédonienne WWF France. Côté parcours, j’ai fait un master en biologie et écologie marine à Marseille il y a une quinzaine d’années. Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie début 2016, d’abord pour étudier les baleines, mes autres petites amoureuses avec les tortues ! Comme elles se reproduisent en hiver, il me fallait un sujet d’étude pour l’été… et les tortues caouannes ont pris le relais. J’ai commencé avec l’association Bwärä Tortues Marines à Bourail, puis j’ai rejoint le WWF, qui lançait aussi des programmes de suivi dans le lagon Sud. Aujourd’hui, ça fait six ans que je travaille sur cette thématique.
__
Ta thèse porte un titre plutôt costaud : « Caractérisation et enjeux de conservation d’une zone de ponte de tortues caouannes appartenant à la population en danger critique d’extinction du pacifique sud – le Grand Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie ». Bon, dit comme ça, ça impressionne un peu, peux-tu nous expliquer en version décryptée ce que ça veut dire et en quoi consistait ce travail ?
En réalité, le titre devient plus clair si on le décompose ! Ma thèse porte sur la tortue caouanne, que l’on appelle « tortue grosse tête » en Nouvelle-Calédonie, une espèce de tortue marine présente dans les mers chaudes et tempérées du monde. Aujourd’hui, elle est classée « vulnérable » sur la liste rouge de l’UICN, mais dans le Pacifique Sud, elle est en danger critique d’extinction. On estime qu’en un siècle, 80% de cette population a disparu.
En Nouvelle-Calédonie, nous avons une responsabilité particulière, car cette espèce ne se reproduit que dans deux pays du Pacifique Sud : l’Australie et ici. Il était donc crucial d’étudier où et comment elle pond dans le Grand Lagon Sud, une zone encore peu connue. Contrairement à la Roche Percée, où les suivis existent depuis longtemps, les îlots du lagon Sud, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, restaient un mystère.
Mon travail a consisté, avec l’IRD, la Province Sud et d’autres partenaires, à identifier les sites de ponte, comprendre le comportement des tortues et proposer des recommandations concrètes pour améliorer leur protection. L’objectif final étant de transformer ces connaissances en actions de conservation efficaces.
__
Pendant tes recherches, tu as découvert que les plages du Grand Lagon Sud favorisent la naissance de nombreux nouveau-nés mâles, contrairement à d’autres sites comme la Roche Percée. Comment cette particularité peut-elle aider à préserver l’équilibre des populations de tortues caouannes face au réchauffement climatique ?
C’est l’une des bonnes surprises de nos recherches ! Les tortues marines, comme tous les reptiles, voient le sexe de leurs bébés déterminé par la température du nid : plus il fait chaud, plus il y a de femelles ; plus c’est frais, plus il y a de mâles. Avec le réchauffement climatique, on observe une féminisation croissante des populations, ce qui pose un risque majeur pour la reproduction : s’il n’y a plus de mâles, il n’y a plus de reproduction et donc plus d’espèce.
À la Roche Percée, par exemple, le sable sombre absorbe fortement la chaleur et génère presque exclusivement des femelles. Mais dans le Grand Lagon Sud, les conditions sont très différentes : sable corallien blanc, plages plus étroites avec davantage d’ombre grâce aux arbres, influence rafraîchissante de l’eau océanique… On s’attendait à un environnement plus frais, mais pas à ce point et c’est une bonne surprise ! Nos relevés ont montré jusqu’à trois degrés de moins par rapport à la Roche Percée, ce qui favorise la naissance de nombreux mâles.
Ce phénomène équilibre donc la population locale et lui offre une chance de survie face au réchauffement climatique. Bien sûr, d’autres menaces existent, comme l’élévation du niveau de la mer qui affecte plus les îlots que la Roche Percée. Chaque site a ses propres enjeux, mais cette découverte nous a permis de comprendre comment cette population a continué à se pérenniser, et c’est une vraie aubaine pour elles !

__
On a cru comprendre que tu as joué les espions high tech en utilisant la télémétrie satellitaire, le marquage et l’analyse génétique pour suivre les tortues. As-tu des anecdotes à nous raconter, des découvertes qui t’ont laissé bouche bée ?
Oui ! On a posé des balises satellites sur les tortues, on a fait de la génétique, on leur a mis des bagues et tout ça nous a amené à nous poser une question : les tortues qui pondent à Bourail et celles du Grand Lagon Sud font-elles partie de la même population ou sont-elles distinctes ? En fait, les femelles sont extrêmement fidèles à leur site de ponte : celles de Bourail restent à Bourail, celles du Grand Lagon Sud restent là-bas. Mais les mâles eux, sont beaucoup moins fidèles que les femelles, c’est une histoire qui se répète… Ils se reproduisent avec les femelles des deux sites. Résultat : c’est bien une seule grande famille, et les mâles nés dans le Grand Lagon Sud aident à rééquilibrer la population de Bourail, qui souffre d’un manque de mâles à cause du réchauffement climatique. Une excellente nouvelle pour leur survie !
Autre chose que l’on a découvert, une fois la saison de ponte terminée, les tortues repartent vers leurs zones de vie pour le reste de l’année. On les a suivies pendant des mois et on a découvert qu’elles voyagent jusqu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, à Fidji. Elles parcourent des milliers de kilomètres à travers le Pacifique !
Ces données nous ont aussi permis d’identifier les autres pays avec qui on devait travailler pour protéger ces populations. Aujourd’hui, on ne se limite pas à la Nouvelle-Calédonie et on collabore avec ces pays où elles passent le reste de leur vie. Les tortues sont de vraies ambassadrices de la mer, de l’écologie, elles connectent les peuples et les cultures du Pacifique.

__
Trois ans de recherches, ça en fait des journées sur le terrain ! Si tu devais nous raconter la journée type d’un chercheur en mode explorateur des lagons, ça donnerait quoi ? Des galères, des moments magiques ?

Il n’y a pas vraiment de journée type, mais plutôt deux saisons. Il y a une grande partie de l’année où on est derrière nos ordis à analyser des données, écrire des rapports et surtout chercher des financements. Et puis, il y a la saison de terrain, de novembre à mars. Là, par contre, c’était assez dingue ! Pendant cinq mois, on passe plusieurs jours par semaine dans le Grand Lagon Sud. On embarque en bateau avec des bénévoles et on vit au rythme des îlots sauvages. Ce sont des endroits fantastiques qui amènent pas mal d’humilité. Parce qu’il n’y a pas que des tortues, il y a aussi des oiseaux marins, des serpents, des poissons, des coraux, des requins, des baleines… Un vrai paquet de monde et ça donne envie de s’engager pour protéger ce patrimoine incroyable. Les journées sont intenses. On passe nos journées à cavaler sur les îlots, et la nuit on ne dort (presque) pas ! Les tortues ne pondent que la nuit, alors on attend qu’elles viennent pour pouvoir les équiper de balises satellites.
__
Tu as soutenu ta thèse le 4 septembre 2024 à l’UNC, devant un jury, les partenaires et la direction scientifique. Ça devait être sacrément impressionnant… Raconte-nous : comment ça s’est passé ? Maintenant que tu as décroché le grade de docteur (rien que ça), quelles sont tes nouvelles perspectives et projets scientifiques à venir en Nouvelle-Calédonie, notamment avec WWF ?

La soutenance finalement ce n’était pas le plus dur. Le vrai défi, c’était la fin de thèse. Des mois à ne faire que ça, jour et nuit, avec très peu de sommeil (c’est un thème récurant de ne pas beaucoup dormir). Mais la soutenance, c’était presque une formalité. Le plus dur c’était de rédiger un manuscrit qui synthétise trois ans de recherches en un seul document. La soutenance c’était surtout un moment de partage, une belle façon de clôturer cette aventure collective avec toutes les personnes qui ont contribué au projet, avec qui on a réfléchi, galéré, et remporté des victoires. Ce qui comptait vraiment, ce n’était pas tant d’avoir le titre de docteur, mais de voir l’impact concret de nos travaux : des outils de gestion et de conservation mis en place, et surtout, l’espoir que les tortues calédoniennes s’en porteront mieux grâce à tout ça.
Depuis, j’ai directement continué avec mon poste de coordinateur des programmes marins au WWF. Ça fait plus d’un an et demi que je suis en poste, avec un portefeuille de projets un peu plus important. Je travaille toujours sur les tortues, bien sûr, mais pas seulement. On mène des actions dans le Grand Lagon Sud, sur les îlots d’Entrecasteaux et Chesterfield, qui sont des sites de ponte exceptionnels du Parc Naturel de la Mer de Corail. On collabore aussi avec l’association Bwärä Tortues Marines pour développer des nurseries capables de faire chuter la température des nids, et avec Fidji sur des initiatives de conservation des tortues. Il y a aussi des projets sur les dugongs et les récifs coralliens. Donc je continue avec le WWF, c’est un super boulot !
__
Bon, pour parler sérieux (mais pas trop) : avec tout ce boulot sur la planche, quel serait ton conseil pour les jeunes chercheurs qui voudraient se lancer dans une thèse ? Spoiler alert : motivation et passion obligatoires non ?
C’est sûr, pour les jeunes chercheurs qui voudraient se lancer dans une thèse, c’est de la passion mais surtout de la motivation et de l’engagement. Ce n’est pas forcément plus dur que d’autres boulots. J’ai vu des chercheurs brillants qui n’étaient pas forcément passionnés au départ et qui ont trouvé leur voie en chemin. Ce qui fait vraiment la différence, c’est l’engagement et l’envie d’apprendre. Moi, j’ai eu la chance de faire une thèse qui me plaisait à la congruence entre la recherche et la conservation. Ce n’était pas une thèse purement académique, il y avait des enjeux concrets derrière : comment protéger les tortues en Nouvelle-Calédonie, à Bourail, dans le Grand Lagon Sud ? Avoir une application directe, ça donne du sens et ça motive encore plus.
Donc mon conseil pour ceux qui veulent se lancer, ne lâchez pas vos rêves, mais donnez-vous les moyens de les réaliser. Il faut y aller avec conviction et humilité, être curieux, vouloir apprendre… et surtout, réseauter ! Le milieu est compétitif, il y a beaucoup de monde et peu de postes. Ce qui fera la différence, c’est votre capacité à créer des liens, à vous investir dans des assos, à être actif sur le terrain. Alors let’s go, ! Il y a du boulot et on a besoin de monde, alors mettez toutes les chances de votre côté !
__
Si tu pouvais glisser un message dans une bouteille pour sensibiliser le grand public à la conservation des tortues et des écosystèmes marins calédoniens, qu’écrirais-tu sur ton petit papier ?
Excellent l’image de la bouteille à la mer ! Je vais répondre comme un scientifique et pas commun pirate. Si je devais glisser un message dans une bouteille, il serait simple et factuel : la plus grande menace pour les tortues marines, ici comme ailleurs, c’est la pêche industrielle. Pas parce qu’elle les vise directement, mais à cause des prises accessoires : des tortues qui se retrouvent piégées dans des filets ou accrochées à des hameçons, et qui meurent noyées. Alors, le meilleur moyen de protéger les tortues, c’est de réduire, voire arrêter notre consommation des produits de la mer qui sont issus de la pêche industrielle.
On a de la chance d’avoir un système récifal en bonne santé avec une pêche locale durable. Mon message, ce serait donc : « Mangez moins, mais mangez mieux ! ». Allez au marché, achetez un poisson du lagon, qui a été pêché par votre voisin, votre cousin. En plus de préserver l’environnement, vous soutiendrez l’économie locale.

__
Allez, pour finir sur une note un peu plus fun, si les tortues caouannes pouvaient parler à nos lecteurs, qu’est-ce que tu penses qu’elles leur diraient sur l’état des océans et sur nos efforts pour les préserver ?
Je ne sais pas pourquoi, mais si une tortue pouvait nous parler, je l’imagine avec une voix de grand-mère. Genre « Grand-Mère Feuillage« , pleine de sagesse et de patience. Les tortues sont là depuis 110 millions d’années, elles ont vécu avec les dinosaures, traversé des extinctions massives et des bouleversements climatiques et elles sont toujours là. Alors je pense qu’elle nous dirait que la plus grande menace pour l’humanité aujourd’hui, c’est l’humanité elle-même. Parce que soyons honnêtes, on est en train de saboter notre propre avenir et celui de la grande majorité des espèces du vivant. Alors peut-être que c’est ça qu’elle nous dirait : « Il est temps d’être sérieux, les enfants.”.

__