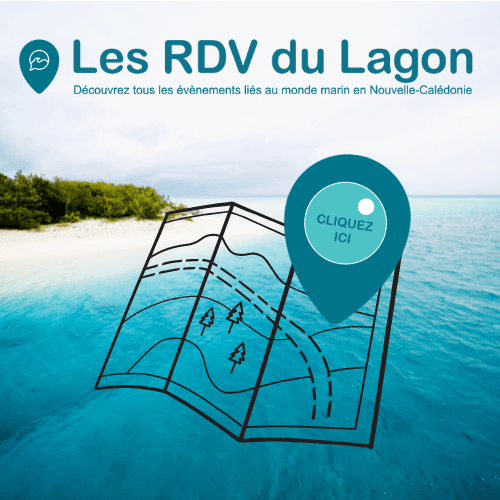Si la crevette bleue est la star incontestée de la Nouvelle-Calédonie, il fallait bien quelqu’un pour garder un œil sur sa santé économique. Et c’est là qu’entre en scène l’Observatoire économique aquacole, discret mais essentiel, hébergé au sein de l’Agence rurale. Derrière les chiffres, les graphiques et les bilans annuels, il y a Virginie Roussery, chargée d’études, qui connaît la filière sur le bout des antennes. Depuis 2017, elle compile, analyse et décrypte les données de production de la crevette calédonienne, pour éclairer les décisions publiques et accompagner les aquaculteurs. Entre rigueur, passion et précision, Virginie veille à ce que la filière garde le cap.
__
Bonjour Virginie, et bienvenue sur NeOcean ! Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de ton parcours pour être, aujourd’hui, chargée d’études à l’Agence rurale ?
Alors, moi je suis ingénieure agroalimentaire de formation, et j’ai commencé mon parcours dans le domaine de la qualité, où j’ai occupé plusieurs postes de responsable qualité, notamment dans le secteur de la pêche, un milieu que je connais bien depuis mon arrivée en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, j’ai travaillé pour le groupe Nord Avenir, au sein de sa filière agroalimentaire FINAGRO. Là, je supervisais les aspects qualité pour différentes entités : les Pêcheries du Nord, la SICA (provendier), le Groupe Gourmand, ainsi que des missions ponctuelles sur l’écloserie Eori.
Ensuite en 2017, j’ai eu l’opportunité d’intégrer ce qui s’appelait à l’époque l’ERPA (l’Établissement de Régulation des Prix Agricoles) avant sa fusion avec l’APICAN (Agence Pour l’Indemnisation des Calamités Agricoles ou Naturelles) qui a donné naissance à l’Agence rurale en 2019. J’ai intégré l’ERPA et l’Observatoire à ce moment-là, et depuis, j’y suis restée. Aujourd’hui, au sein de l’Agence rurale, je m’occupe de l’Observatoire aquacole, mais j’interviens aussi sur d’autres filières, comme les intrants, la pêche côtière, le système de management de la qualité au sein de l’établissement et la transition énergétique. Mais clairement, ma grosse casquette, c’est la crevette. Je gère les aides, les échanges avec la SOPAC, les aquaculteurs et la recherche.
__
L’Agence rurale héberge l’Observatoire économique de la filière aquacole depuis 2008, peux-tu nous expliquer ce qu’est cet Observatoire, et pourquoi il a été créé ?
Alors l’Observatoire, il existe depuis 1999. À l’époque, c’était le tout début de la filière aquacole en Calédonie, donc il a été créé pour répondre à un vrai besoin : centraliser les données économiques et techniques d’une filière toute naissante. Au départ, il était logé au GFA (Groupement des Fermes Aquacoles), puis il a migré en 2008 au sein du l’ERPA, ce qui a marqué une nouvelle étape. Aujourd’hui, c’est complètement géré par l’Agence rurale ; aussi bien la partie financière, qu’humaine.
Les missions n’ont pas vraiment changé depuis le début. Il s’agit de centraliser, produire, valoriser et diffuser les données techniques et économiques pour éclairer les décisions stratégiques de la filière. Concrètement, je récupère les résultats techniques et économiques des écloseries et des fermes, grâce à des fichiers remplis chaque année par chaque entité. Ensuite, je les retraite de manière identique pour obtenir des ratios comparables, et je fais valider les données par chacune des entités avant de tout agréger. Chaque année, on fait donc une restitution officielle auprès de la filière, pour les institutions et les professionnels. C’est un peu « la grand-messe » où l’on présente le bilan technico-économique de l’année précédente. Seules des données agrégées sont diffusées. Notre engagement principal, c’est la confidentialité des données individuelles, et ça fait partie de notre ADN.

__
Sur le terrain, comment collectez-vous vos données et quels indicateurs suivez-vous en priorité ?

On prépare des fichiers Excel, validés par le comité de pilotage de l’Observatoire, qui fixent les indicateurs à suivre à partir d’un cahier des charges. Au niveau technique sur la partie écloserie, on regarde la production de post-larves : combien de cycles, les répartitions, les pertes éventuelles… Sur la partie ferme, on suit les surfaces ensemencées, les tonnages produits, les poids moyens, les taux de survie, les rendements, les indices de conversion (c’est-à-dire combien de kilos d’aliments pour produire un kilo de crevette), les durées d’élevage, etc. L’indice de conversion, c’est vraiment le nerf de la guerre, parce que l’aliment, c’est ce qui pèse le plus dans le coût de production. On suit ces indicateurs depuis plus de vingt ans, donc on a un bon recul pour voir les fluctuations et les tendances.
Ensuite, pour la partie économique au niveau des écloseries, on va regarder combien coûte la production des post-larves, quels ont été les charges et les résultats financiers au niveau de ce maillon. Ça va être la même chose pour les fermes, c’est-à-dire qu’on va relever les chiffres d’affaires ateliers, le chiffre d’affaires sur le marché local, les charges variables (coût des post-larves, de l’aliment et de la pêche), les charges fixes (personnel, énergie, maintenance, frais généraux, amortissements financiers). Tout ça nous permet de calculer le coût de production moyen d’un kilo de crevette, qui est l’indicateur clé de la filière.
__
Quand on regarde ces chiffres, année après année, est-ce que vous constatez des évolutions marquantes dans la filière ?
Oui, le plus marquant, c’est le fléchissement de la production. Au début de la filière, on dépassait les 2 500 tonnes par an. Aujourd’hui, et depuis plusieurs années, on est plutôt autour de 1 350 tonnes. Mais ça ne s’est pas fait du jour au lendemain ! Certaines fermes ont dû s’arrêter temporairement pour travaux, d’autres ont rencontré des difficultés financières ou techniques.
De plus, nous sommes dépendants du climat ; les années de La Niña par exemple sont souvent des années compliquées pour l’aquaculture, avec des températures plus hautes en bassin qui demandent beaucoup d’oxygénation, de renouvellement d’eau, des apports en eau douce qui peuvent être conséquents et facteurs de stress. Or, on sait que tout ce qui stresse la crevette, va contribuer à la mortalité.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles ! Deux fermes rouvrent, des travaux ont été faits, et on observe une vraie amélioration des rendements. Sur les cinq dernières années, les surfaces ensemencées ont certes diminué, mais les rendements en tonnes par million de post-larves ont progressé. Ça montre une meilleure maîtrise technique des élevages.
__
Une fois que ces données sont collectées, en quoi aident-elles les différents acteurs de la filière ?
Les données techniques et économiques, c’est une base de travail pour tout le monde. Elles permettent aux acteurs d’identifier leurs points forts et leurs marges d’amélioration, de suivre l’évolution d’année en année et d’adapter leurs pratiques.
Pour les institutions, c’est un vrai outil d’aide à la décision. Ça permet d’avoir des éléments objectifs actualisés sur l’état et les dynamiques de la production. Ces informations permettent d’orienter les politiques publiques, d’ajuster les dispositifs d’accompagnement et de soutien, et de mieux anticiper les besoins du secteur.
Et pour les aquaculteurs, c’est un repère ; ils peuvent se situer par rapport à la moyenne de la filière et comprendre leurs résultats ; c’est un support pour échanger et s’entraider. C’est vraiment un travail collectif.

__
Pour finir, si la crevette bleue devait avoir une “fiche d’identité”, quels seraient selon toi ses super-pouvoirs et ses petits points faibles ?
Ses super-pouvoirs, ce serait clairement sa rareté gage d’exclusivité, sa couleur unique, sa saveur délicate et raffinée, et sa texture fine et fondante. C’est vraiment un produit d’exception, et il faut qu’on continue à valoriser cette image-là !
Et son petit point faible, je dirais sa sensibilité aux variations climatiques, qui peuvent affecter sa croissance et sa survie. Ça demande une attention technique constante et un vrai savoir-faire. Mais sinon, elle n’a pas grand-chose à se reprocher, notre crevette bleue !
__