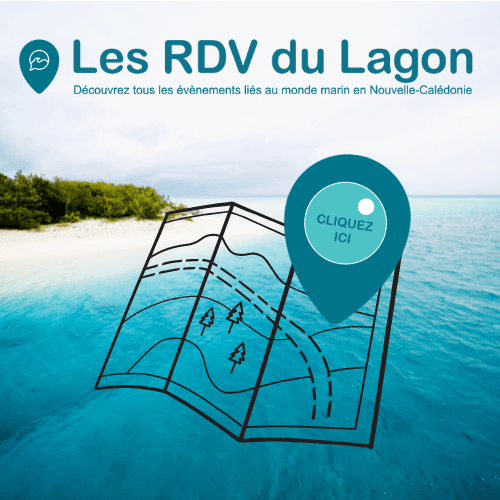La rédac’ est allée à la rencontre d’une figure emblématique de la recherche marine en Nouvelle-Calédonie… Claude Payri, directrice de recherche à l’IRD, a consacré plus de quarante ans de sa vie à explorer, comprendre et faire connaître la richesse des écosystèmes marins du Pacifique. Spécialiste des macroalgues, elle a sillonné les lagons de Polynésie, les récifs de Nouvelle-Calédonie et bien d’autres horizons océaniques, multipliant les expéditions et les découvertes. C’est au début du mois d’août 2025, que son engagement a été salué par l’Ordre national du Mérite, une distinction qui couronne une carrière marquée par la passion, le partage et l’humilité. Claude nous partage ses souvenirs de terrain, son rôle dans la valorisation du Parc naturel de la mer de Corail, ses publications scientifiques et son message aux jeunes générations de chercheurs.
__
Bonjour Claude, bienvenue sur NeOcean ! Tout d’abord félicitations pour votre entrée dans l’Ordre national du Mérite, c’est une belle reconnaissance pour votre parcours, comment l’avez-vous vécu ?
Avec beaucoup d’étonnement, car je ne voyais pas en quoi j’avais du « mérite » si ce n’est d’avoir fait mon travail avec conscience, honnêteté et détermination. J’ai accepté cette reconnaissance avec beaucoup d’humilité et de modestie, car quand on est chercheur, on reste toujours modeste face à ce qu’il reste à découvrir. Le vrai plaisir a été de partager cette distinction avec celles et ceux qui m’ont accompagnée : les enseignants et chercheurs qui m’ont guidée, les étudiants avec qui j’ai beaucoup appris et tous les personnels techniques avec qui j’ai eu l’occasion de travailler. J’ai voulu exprimer de la reconnaissance envers l’IRD et toutes celles et ceux qui m’ont fait confiance et qui m’ont permis d’exercer ce métier qui m’a tant apporté. C’était un grand moment de partage, et aujourd’hui ça fait une petite médaille que mon petit-fils aura plaisir à récupérer !
__
Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir biologiste marine, et plus précisément spécialiste des macroalgues ?
Ça paraît toujours étonnant, mais c’est quelque chose que j’ai décidé très jeune, vers dix ans. À la faveur de la lecture d’un ouvrage qu’une de mes tantes m’avait offert sur les animaux étranges des fonds marins. J’ai grandi en Algérie et je passais mes vacances au bord de la Méditerranée où j’ai découvert les fonds marins en masque et palmes, dès l’enfance. Tout ça a vraiment été ce qui a déterminé ma voie. Par la suite, j’ai quitté le foyer familial pour Montpellier, où j’ai choisi un double cursus en botanique et océanographie, encouragée par des enseignants passionnants. C’est en Polynésie, à Moorea, que ma carrière de phycologue a vraiment commencé : j’y ai réalisé mon DEA puis ma thèse sur les algues, avec un directeur spécialiste du Pacifique. J’ai poursuivi en Polynésie comme enseignante-chercheuse, réalisant le rêve de ma vie, celui d’enseigner et faire de la recherche dans le contexte extraordinaire des récifs coralliens. Puis j’ai rejoint la Nouvelle-Calédonie, où un autre monde marin s’est ouvert à moi et où l’IRD m’a offert les moyens de travailler avec de nombreux pays du Pacifique, de l’océan Indien et des Caraïbes.



__
Parmi toutes vos expéditions (Clipperton, Fidji, Salomon, etc.), y en a-t-il une qui vous a particulièrement marquée ou fait vivre un moment insolite ?
C’est une question difficile ! Aucune campagne ne ressemble à une autre, chacune a sa singularité liée aux lieux et aux rencontres. Certaines ont été administrativement compliquées, comme aux Salomon, mais toujours enrichissantes par les contacts humains ! Mais je dois dire que la Nouvelle-Calédonie reste marquante par la richesse et la diversité de ses milieux, accessibles de façon régulière, ce qui permet de vraies découvertes scientifiques. J’ai fait des collectes ou des trouvailles qui m’ont beaucoup émue et tenue en haleine. Je garde aussi un souvenir fort des Chesterfield, de l’île des Pins et du lagon sud, des milieux vraiment extraordinaires. À Madagascar, j’ai été touchée par la gentillesse des habitants malgré la pauvreté, et par la beauté des fonds. Ce que je retiens surtout, c’est la passion partagée avec mes collègues lors de ces moments privilégiés en campagne. C’est sans doute ce contact entre passionnés qui me manquera le plus dans une vie de retraitée. Parce que nous sommes des malades de passion !
__
Quel rôle jouent, selon vous, les macroalgues dans les récifs coralliens, et dans la lutte contre le changement climatique ?
Les macroalgues sont essentielles aux écosystèmes récifaux. Certaines consolident les récifs en précipitant le carbonate de calcium, elles participent toutes aux grands cycles de la matière en produisant de l’oxygène et en captant du dioxyde de carbone. Elles sont aussi source de substances naturelles recherchées pour la pharmacologie, la cosmétique, l’alimentation ou d’autres industries. Paradoxalement, elles sont souvent négligées dans les études, alors qu’on ne peut pas imaginer un récif corallien sans algues. Concernant le changement climatique, certaines sont déjà affectées par la hausse des températures, l’acidification et la baisse d’oxygène. Certaines espèces disparaîtront du paysage, d’autres apparaîtront ou s’adapteront. Quoi qu’il en soit, on doit s’attendre à une modification plus ou moins profonde du paysage sous-marin. Contrairement aux mangroves ou aux herbiers marins, les algues ne stockent pas le carbone dans le sol car elles n’ont pas de racines, mais elles participent activement à la capture du CO2 et participent aux équilibres écologiques. En Nouvelle-Calédonie, on observera sans doute une disparition progressive d’espèces tempérées du lagon sud, remplacées par des espèces plus tropicales adaptées aux températures plus chaudes. Certaines d’entre elles pourraient venir d’autres régions. D’où l’importance des collections naturalistes, qui constituent un patrimoine scientifique, mais également une mémoire. Elles permettent de suivre l’évolution des flores au fil du temps.



__
Vous avez dirigé l’ouvrage “Nouvelle-Calédonie, un océan de savoirs”, publié en juin 2025. Qu’est-ce qui vous a poussée à coordonner cet ouvrage ?

En 2018, j’avais déjà coordonné un premier ouvrage intitulé « Nouvelle-Calédonie, Archipel de Corail » pour célébrer l’année internationale des récifs coralliens. L’idée de ce nouvel ouvrage est née au sein du comité scientifique du Parc naturel de la mer de Corail, que je présidais, pour célébrer ses dix ans et marquer la fin de notre mandature. Les événements de 2024, ont renvoyé l’édition de l’ouvrage en 2025, décrétée « Année de la Mer ». Ce fut l’opportunité d’une parution pour la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3), qui s’est tenue à Nice en juin 2025.
L’ouvrage dresse un panorama des recherches majeures menées ces vingt dernières années dans le Parc. Cet ouvrage, rédigé pour le plus grand nombre, met en avant les regards croisés entre science et société, réunissant scientifiques, coutumiers, décideurs, gestionnaires, associations, usagers, etc. Il est collectif et ouvre un regard sur cet espace lointain et méconnu. C’est un legs au Parc et aux Néo-Calédoniens, mais aussi, grâce à la version anglaise, un lien avec les autres régions océaniennes.
__
En repensant à ces 40 ans de carrière dans les Outre-mer et le Pacifique, quel est le plus beau souvenir que vous retenez ?
C’est une question difficile, car des souvenirs merveilleux s’égrènent au fil de ces quarante ans. On me demande souvent ce que j’ai préféré entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, j’ai aimé autant ces deux périodes et ces deux pays qui sont deux mondes très différents, mais tout aussi attachants et que je ne pourrais jamais opposer. Si je devais retenir deux moments, ce seraient mes débuts en Polynésie, à Moorea, où j’ai découvert les récifs coralliens et leurs algues avec émerveillement, et la période en Nouvelle-Calédonie, où j’ai pu approfondir mes recherches et découvrir d’autres pays du Pacifique. Ces deux périodes, l’une marquant le commencement et l’autre la maturité, sont pour moi les plus marquantes.



__
Qu’aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations de scientifiques, en particulier aux femmes qui envisagent une carrière en sciences marines ?

Je leur dirais de ne pas se décourager. J’ai eu de très nombreuses étudiantes, la majorité de mes doctorantes étaient des jeunes femmes. Il faut persévérer et surtout faire ce que l’on a vraiment envie de faire. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse s’offrir, même si le chemin est parfois semé d’embûches. Il me vient un souvenir d’enfance, d’une rédaction scolaire sur un texte de Champollion qui disait qu’une vie réussie, c’est réaliser dans l’âge adulte son rêve d’enfance. C’est ce que j’ai eu la chance de faire, réaliser le rêve de mon enfance de devenir océanographe. C’est ce message que je veux transmettre, ne jamais abandonner son rêve !
__